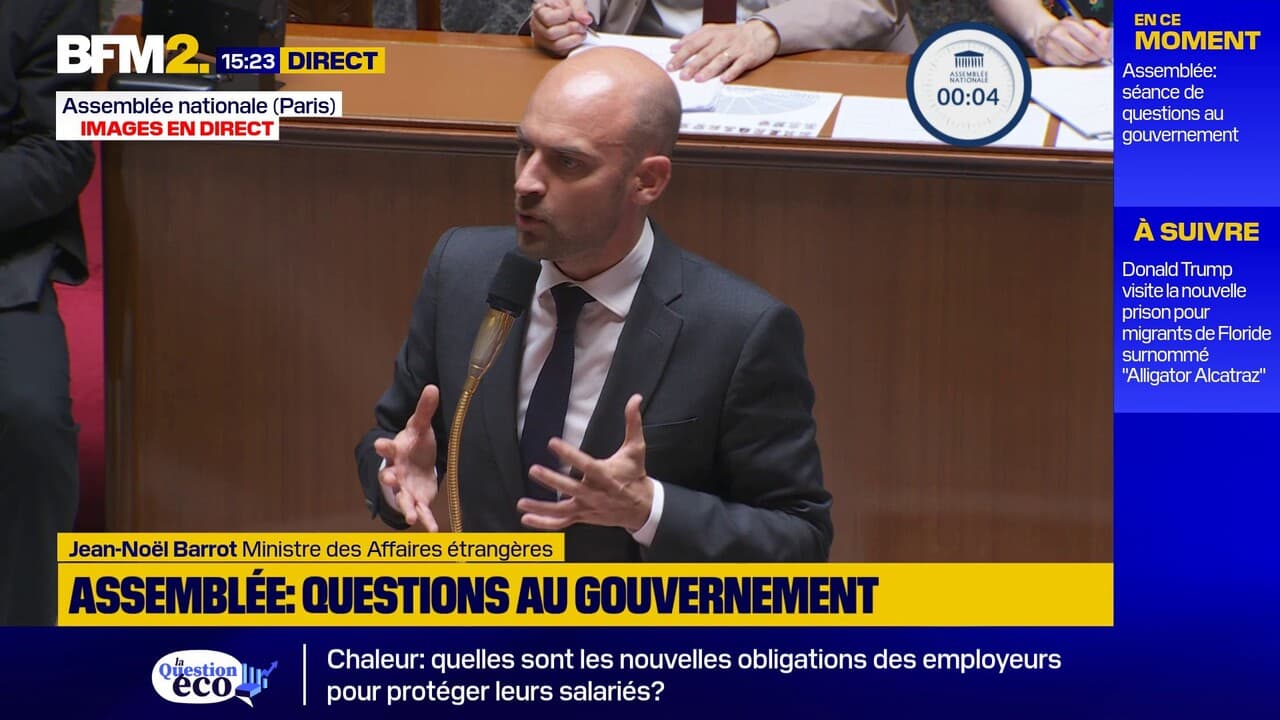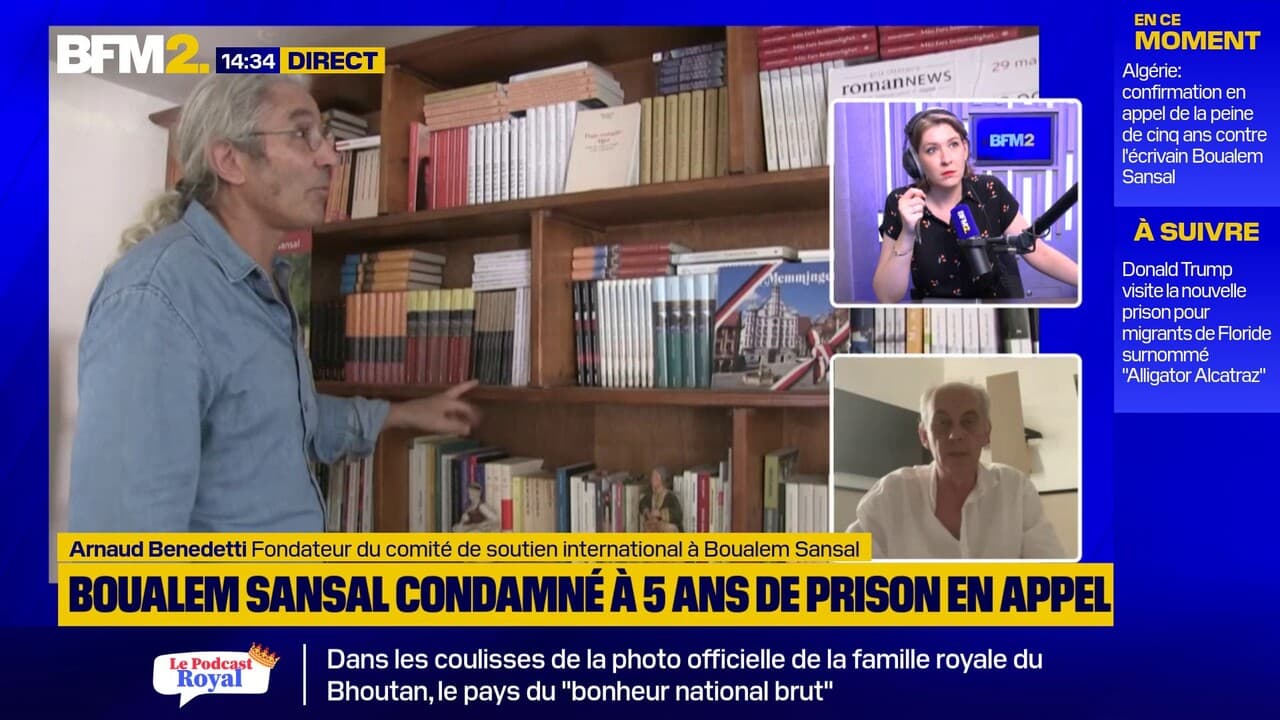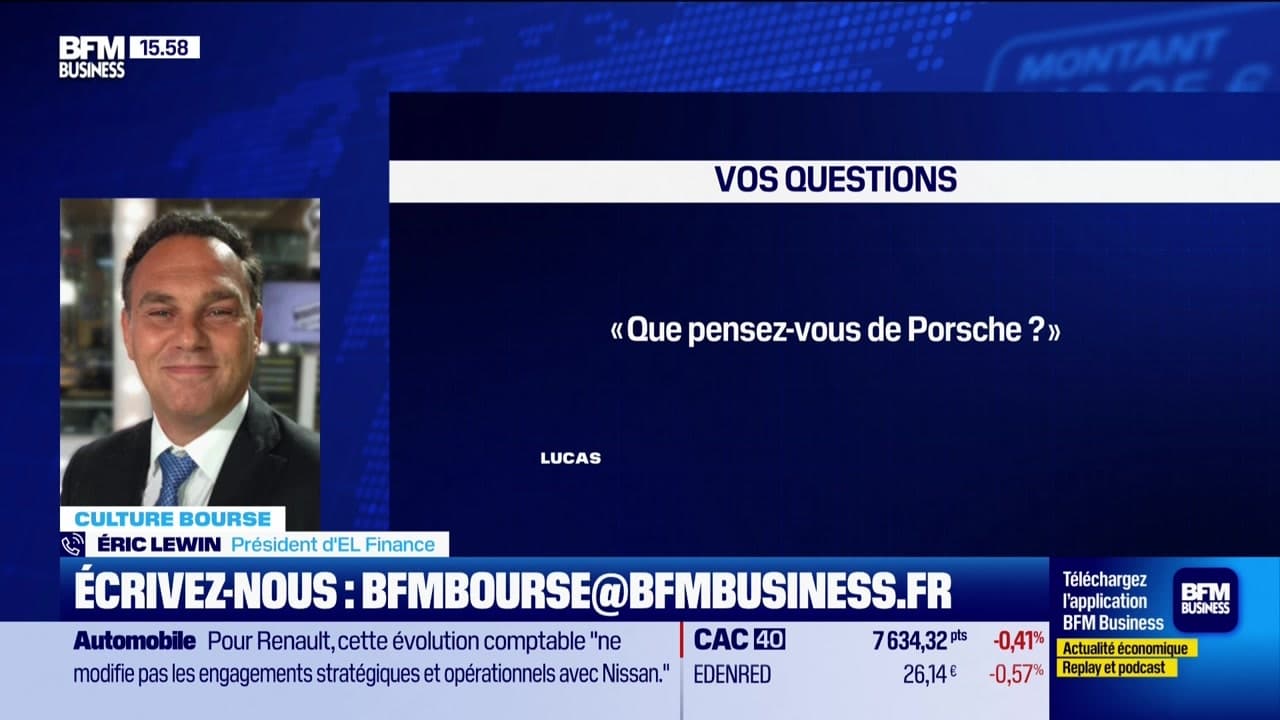La romancière Florence Delay, quatrième femme élue à l’Académie française, vient de s’éteindre à l’âge de 84 ans.
Jeanne d’Arc dans le film de Robert Bresson en 1962, l’académicienne et éphémère actrice Florence Delay, décédée mardi à 84 ans, a exprimé dans ses livres une passion jamais démentie pour l’amour courtois, le théâtre et l’Espagne.
Fille de l’académicien Jean Delay, elle fut en 2000 la quatrième femme à être admise au sein de l’institution, après Marguerite Yourcenar, Jacqueline de Romilly et Hélène Carrère d’Encausse.
Florence Delay a été jurée du prix Femina (1978-1982), membre du comité de lecture de Gallimard (1979-1987), membre du conseil de rédaction de la revue « Critique » (1978-1995), chroniqueuse dramatique de « La Nouvelle Revue française » (1978-1985) et membre du comité de lecture de la Comédie-Française (2002-2006).
Née à Paris le 19 mars 1941, elle se prend de passion, alors étudiante, pour Federico Garcia Lorca, passe l’agrégation d’espagnol, s’oriente vers la littérature générale et comparée qu’elle enseignera à la Sorbonne.
Passion pour l’espagnol
Sa passion pour l’espagnol lui venait de vacances passées, enfant, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), chez son grand-père, Maurice Delay, chirurgien et homme politique qui fut le maire de cette ville de 1947 à 1958.
« Je voulais faire du théâtre (…) mais mon père m’a mis un marché en mains: si je choisissais l’agrégation d’espagnol, tradition familiale, il m’offrait un studio. Très bonne décision au fond, car j’ai pu exercer un métier magnifique, l’enseignement. Je remercie mon père », a-t-elle dit.
C’est grâce au cinéma qu’elle fit d’abord parler d’elle: Robert Bresson la rencontra et fut séduit par son visage lumineux au regard clair, auréolé de blondeur, jusqu’à lui donner le rôle-titre dans son film « Le procès de Jeanne d’Arc ».
« Florence Delay a cette grâce intemporelle, une féminité légère, vibrante, une spontanéité juvénile (…) qui sont autant de nuances perceptibles dans les fulgurantes répliques du +Procès+ « , a écrit le Figaro à propos de son jeu. On la verra ensuite dans une poignée de films, dirigée par Chris Marker, Benoît Jacquot ou Michel Deville.
Elle publie son premier roman, Minuit sur les jeux, en 1973, évoquant un thème qui va être un leitmotiv de livres à venir, l’amour courtois.
Elle obtient le Femina en 1983 pour Riche et légère, le prix François Mauriac en 1990 pour « Etxemendi », le grand prix du roman de la Ville de Paris en 1999 et le prix de l’Essai de l’Académie française pour Dit Nerval. Il s’agit d’un hommage indirect à son père, écrivain et grand psychiatre, ainsi que fervent lecteur de Gérard de Nerval.
Stagiaire de Jean Vilar au Festival d’Avignon
Membre correspondant en France de la Real Academia Española (équivalent espagnol de l’Académie française), Florence Delay a traduit des textes, entre autres, de Lorca, José Bergamin ou Ramon Gomez de la Serna.
Elle avait été stagiaire de Jean Vilar au Festival d’Avignon et assistante de Georges Wilson au TNP au début des années 1960. Pour la scène, elle a notamment traduit La Célestine de Fernando de Rojas, mise en scène par Antoine Vitez en 1989. Elle a composé, avec le poète Jacques Roubaud, un cycle de dix pièces intitulé Graal théâtre, parues entre 1977 et 2005.
Son dernier essai original paru, Il n’y a pas de cheval sur le chemin de Damas (2021, Seuil), est une plongée dans l’imagerie chrétienne et littéraire.
Mariée au producteur Maurice Bernart, elle est la sœur de Claude Delay (née en 1934), psychanalyste et autrice de romans et de biographies (sur Coco Chanel, la poétesse russe Marina Tsvetaïeva ou les frères Alberto et Diego Giacometti).